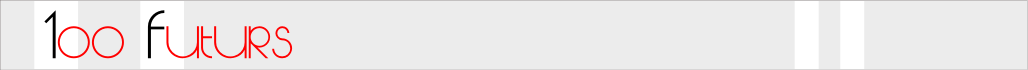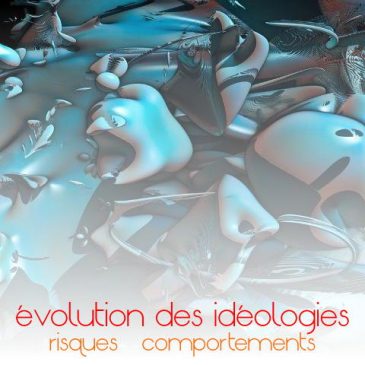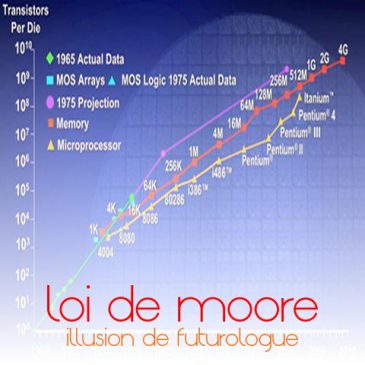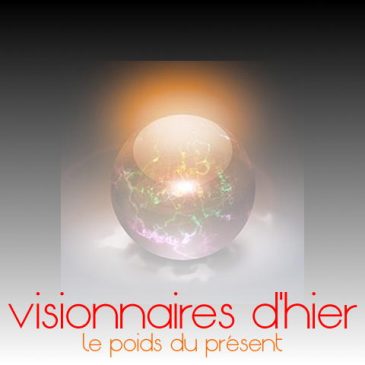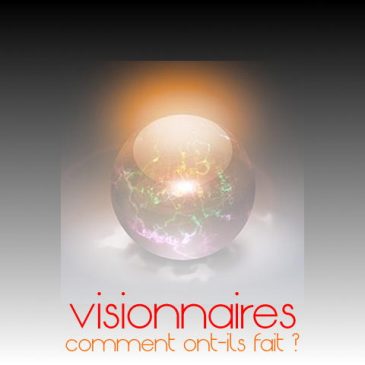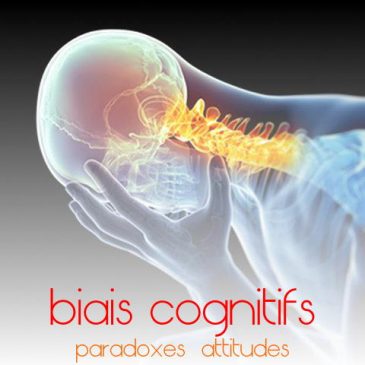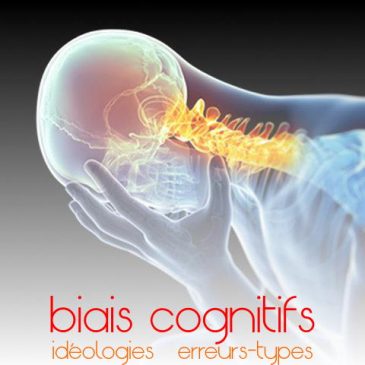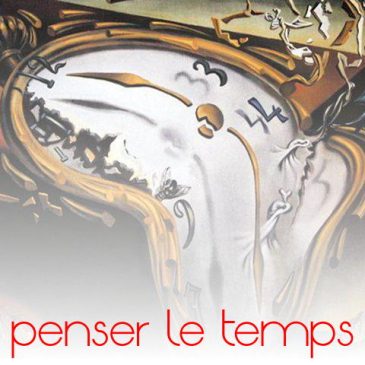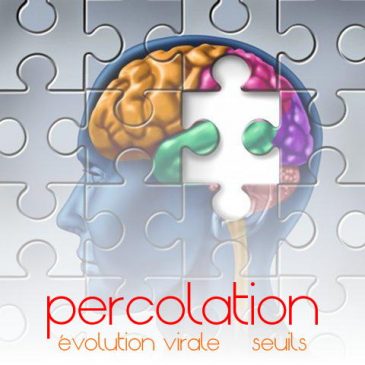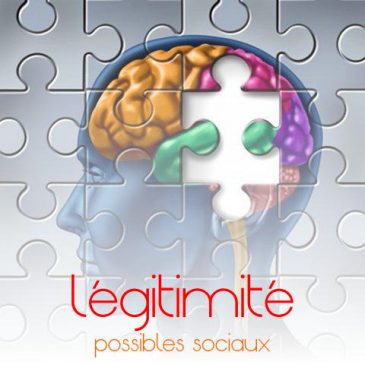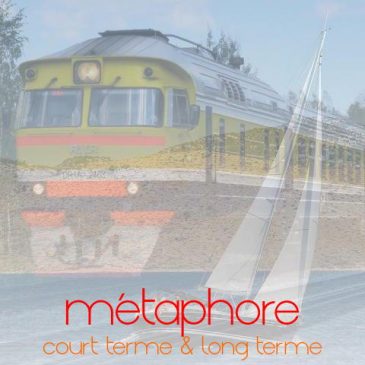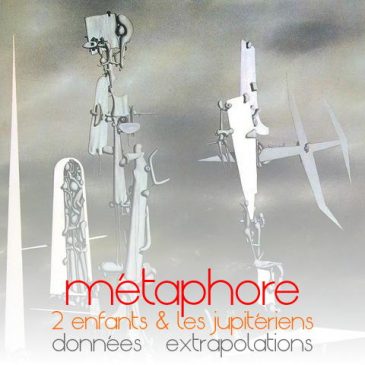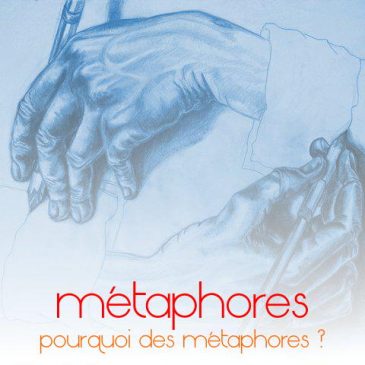le futur des interfaces selon 3 approches
Le futur des interfaces envisagé sous trois angles: l’approche par les possibles, l’approche par les tendances, l’approche par les champs de forces. Ce qui va être mis en évidence par ce survol rapide, c’est que la prévision, celle qui se situe au-delà des projections courtes, nécessite un travail approfondi de construction préalable dont l’approche multiple constitue le premier composant.