L’histoire de l’image peut s’écrire comme l’augmentation continue de sa présence dans notre quotidien. Quels seront …demain… nos rapports à l’image… de demain?
L’image – comprise comme un contenu visuel séparé du monde par un cadre (
*) – fut longtemps le produit exclusif d’une création. Deux grandes révolutions ont transformé le monde de l’image: la photographie et la révolution numérique.
l’image comme produit
Avec la photographie – et sa déclinaison en vidéo – l’image n’a plus seulement été créée, mais également captée, ce qui a amené à la situation inflationniste que nous connaissons aujourd’hui: chaque minute dans le monde signifie trois millions de photos et cinq cents heures de vidéos. Car la captation (92% par smartphone
-> ), s’opère par un outil disponible en permanence et ne demande aucun savoir-faire, l’effondrement des savoir-faire apparaissant à la fois comme la cause et l’effet de l’inflation dans ce domaine (voir “
que va-t-il en rester: photos et vidéos?”)
La révolution numérique a rendu l’image facile à transformer, mais surtout facile à stocker.
Cette dernière caractéristique installe l’image dans un paradoxe: alors que l’inflation tend à la rendre éphémère, le stockage tend à la rendre potentiellement éternelle.
Que devient une image particulière dans un contexte d’inflation?
«À peu près rien» aurait été la bonne réponse d’hier. «L’élément d’une base de données graphique» est devenue la bonne réponse d’aujourd’hui. Mais seul un logiciel est en mesure d’opérer et de combiner des choix pertinents dans une énorme base de données. L’IA générative avait ainsi vocation à s’imposer un jour ou l’autre.
La transformation d’images stockées dans des bases de données graphiques s’est ainsi substituée à la création ex nihilo d’antan. Encore dominante hier, la “feuille blanche” est devenue marginale dans le processus. On retrouve là un principe similaire à celui de la création musicale par plagiat, mix et remix.
En marge de la création proprement dite, la transformation d’images peut obéir à plusieurs motifs comme l’amélioration qualitative du contraste et des couleurs, l’élimination d’effets parasites ou la focalisation sur l’expression d’une idée. Elle peut transformer l’expression du vrai qu’était la captation pour la mettre au service de l’illusion… ou du mensonge.
L’amélioration et la falsification des images mettent en œuvre les mêmes processus. Le mensonge est moins dans l’image que dans le discours – réel ou implicite – qui l’accompagne. Les peintures rupestres n’étaient peut-être rien d’autre que des mensonges si elles illustraient les exploits de chasseur d’un chef de tribu.
de l’image mentale à l’image publique
Selon Aristote «jamais l’âme ne pense sans image». Perception, imagination, mémoire, intelligence, communication, projet: les images mentales occupent nos pensées. Ce qui amène notre propos à s’intéresser aux relations qu’elles entretiennent avec la création “d’images publiques”.
L’image mentale fut longtemps l’incontournable préalable à la création. Celle-ci était progressive issue d’un dialogue entre l’image mentale et sa représentation. L’une interagissait avec l’autre jusqu’à l’obtention du résultat. L’image mentale n’était pas formellement exprimée et le plus souvent pas totalement… exprimable.
À la différence de la création, la captation d’image n’est pas progressive, mais instantanée. Sa relation à une image mentale en est dès lors très différente. Elle peut même être totalement absente (imagerie médicale, scientifique… ).
L’image mentale étant associée à la subjectivité, sa remise en cause par la captation a donc été associée à la représentation du “vrai”… un nouveau statut de l’image en a découlé.
Dans le cadre d’une transformation par mix et remix, l’image mentale devient plus explicite puisqu’elle débouche sur le choix des images sources. L’IA générative va encore plus loin puisqu’elle oblige à exprimer par des mots ce qui tient lieu d’image mentale. Celle-ci devient par là… un descriptif. En cela elle a probablement… disparu.
Ces mots par lesquels l’IA va identifier les images dans une immense base de données graphiques doivent être usuels et avoir le même sens pour tout le monde. Ce qui remplace l’image mentale tend à devenir très convenu. La composante individuelle de l’image mentale tend à se réduire, alors que ses déterminants sociaux tendent à augmenter.
Ainsi, après la captation, nous trouvons dans l’IA générative une autre façon d’évacuer la composante individuelle de l’image mentale. Cela permet là encore de retrouver un certain type de “vrai”, un “vrai” consensuel, celui qui est socialement considéré comme tel dans un descriptif d’images.
image: à propos d’inflation
… l’émergence, sous des formes variables, d’un mode de consommation du temps économe en ressources intellectuelles: l’addiction
Celle de l’image s’inscrit d’autant mieux dans cette hypothèse que l’image se développe aussi en dehors du monde numérique, notamment dans les domaines du street art et surtout du tatouage… et de façon tout aussi inflationniste.
Alors que nous avons l’impression de consommer des images pour elles-mêmes, toute image devient “publiable” et peut être ainsi comprise comme une publicité pour quelque chose, pour quelqu’un, pour soi-même, pour une opinion ou pour un groupe. L’image est à la fois un produit à consommer et la condition même de la consommation de tout autre produit.
L’image tend à devenir autosuffisante. Son discours d’accompagnement est devenu implicite, de ce point de vue elle a tué la rationalité alors que, comme vu plus haut, sa production tend à éliminer l’imaginaire. Comment fonctionnent – et fonctionneront – nos pensées si elles sont privées de l’une et de l’autre?
en guise de conclusion provisoire
L’image ayant acquis une emprise globale sur nos pensées et sur nos pratiques sociales, son futur “logique” consisterait à voir tomber ses limites entre elle et le monde… c’est-à-dire le “cadre” qui permettait de la définir (voir en introduction).
Un univers virtuel est un monde qui entre dans le cadre de l’image, un monde qui, en outre, peut être choisi. Les univers virtuels se prêtent d’ailleurs parfaitement à l’exigence actuelle et probablement irréversible d’une consommation addictive.
Est-il imaginable que des lunettes se substituent à nos anciens – et encore actuels – postes de télévision ?
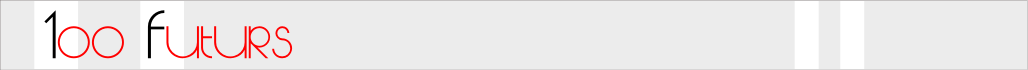

Laisser un commentaire