Scénario: Un virus mutant, insaisissable et destructeur rend inopérants à grande vitesse les serveurs et postes informatiques du monde entier.
Dans l’urgence, une seule parade possible: le confinement. Il s’agirait dans ce cas d’un confinement numérique général immédiat.
Deux questions s’imposent alors: la nature des pratiques alternatives susceptibles d’être mises en œuvre rapidement et les voies par lesquelles elles pourraient, si nécessaire, se consolider.
Les technologies et processus dominants d’aujourd’hui seraient-ils voués à être globalement remplacés?
Sans doute pas. La métamorphose la plus vraisemblable serait sans doute le fruit d’un processus plus complexe.
Dans le scénario évoqué, l’effondrement de la connexion qui organisait les pratiques sociales et économiques à l’échelle de la planète ouvrirait la porte à un rapport de forces nouveau avec d’autres mécanismes existants dont aucun ne serait sans doute en mesure de s’y substituer complètement, même dans le cas d’une dégradation d’envergure.
Sur le plan de l’approche du futur, on peut trouver là une situation – au demeurant plausible – où une transformation radicale des pratiques dominantes ne découle pas d’une “technologie de rupture”, mais plus vraisemblablement des principes développés dans un ancien billet: “la métaphore de l’été indien”.

Il faut remarquer que les éléments en jeu dans les métamorphoses de l’été indien (la chlorophylle, le carotène, les anthocyanes… et le soleil) sont tous présents, depuis le début, et tout au long de la transformation. Ils interagissent. Le changement radical (ici les couleurs des paysages) ne découle pas de l’action d’une force de rupture particulière, mais d’une simple modification du poids relatif des forces existantes au sein du système.
En ce sens, le scénario envisagé peut fonctionner comme un exercice d’école permettant d’esquisser une méthode d’approche applicable à d’autres sujets.
l’évènement fondateur et son contexte
Le contexte de l’évènement qui alimente ce scénario peut s’extrapoler à partir des tendances actuelles.
(*) 6,5 milliards de litres, ou l’équivalent de 2500 piscines olympiques correspondent à la quantité d’eau utilisée par Microsoft en 2022. A cette surconsommation d’eau allant à l’encontre des investissements durables, s’ajoutent les coûts de financement des systèmes d’IA qui ne font qu’augmenter. Le développement massif de technologies utilisant l’IA soulève de nombreuses questions sur l’impact ESG (Environnemental Social et de Gouvernance) de cette technologie très consommatrice en énergies. Comme le relèvent les chercheurs du MIT, les besoins en métaux rares et en eau pour fabriquer les processeurs graphiques et faire fonctionner les datacenters essentiels aux systèmes d’intelligence artificielle ont un impact très négatif.
Une opposition à l’IA qui se renforce et à partir d’elle une hostilité à la “grosse informatique”, celle des datacenters géants. Stimulés par un climat de guerre froide, manifestations, boycotts et sabotages se multiplient, motivés par les immenses consommations d’énergie et d’eau, par le viol à grande échelle des données personnelles, par la mise sous tutelle américaine de l’ensemble des activités publiques ou privées de tous les pays du monde, par les fuites de données, par les attaques répétées sur les serveurs et les postes individuels d’où découlent un nombre croissant de dysfonctionnements dans les pratiques quotidiennes et la vulnérabilité croissante ressentie par les firmes et les individus.
C’est dans ce contexte que surviendrait “le virus”.
que pourrait-il se passer ensuite ?
La remise en état et la surprotection des superstructures amènent à une hausse brutale des contraintes et surtout des prix qui empêche le retour de beaucoup aux pratiques antérieures. Aux coûts déjà astronomiques des serveurs s’ajoutent sans cesse ceux des parades aux agressions et incertitudes de toute sorte que subit le numérique. Les coûts de connexion explosent surtout pour qui exige un niveau de protection élevé et des garanties de continuité de fonctionnement.
Dans le cas qui nous occupe, c’est le principe de l’interconnexion qui se serait considérablement affaibli. L’informatique de spectateur, celle des smartphones et des réseaux sociaux, disparaitrait donc instantanément, entrainant avec elle… beaucoup de choses.
Resterait l’autre.
Le numérique se scinderait en deux groupes avec d’un côté les grandes firmes publiques ou privées et de l’autre le commun des mortels et des petites sociétés, qui n’auraient pas accès aux couts très élevés des nouvelles connexions ultra-contrôlées et ultra-sécurisées.
Le “numérique supérieur” continuerait à fonctionner à peu près comme aujourd’hui. C’est le devenir du “numérique inférieur”, celui du plus grand nombre, qui serait l’objet d’une profonde mutation.
Dans ce second cas, on peut imaginer une phase initiale de bricolage durant laquelle chacun ferait avec ce qu’il a sous la main… à ses risques et périls. Ce ne serait que dans un second temps que de nouveaux processus organisés seraient susceptibles d’émerger.
vers une profonde métamorphose
À priori, rien ne permettrait de remettre en cause les instruments de base désormais traditionnels de la production tels que les claviers, les écrans et plus largement les postes informatiques personnels… pour autant qu’ils ne seraient plus connectés.
Quel serait alors l’équivalent des composants-acteurs de l’été indien, ceux qui sont présents de longue date dans un rapport de forces en voie d’être totalement modifié.
- En premier lieu ce qui existait “avant” la révolution informatique sans pour autant avoir disparu: le papier pour la documentation, pour l’impression de documents, pour l’archivage. Le papier étant resté par ailleurs une place forte de la lecture face aux dispositifs numériques (voir “ prévision: que nous enseigne l’échec du livre électronique?”)
- Le microfilm, qui est resté une place forte de l’archivage: «Bien conservé, le microfilm peut se conserver jusqu’à 500 ans», ce qui va bien au-delà de l’archivage sur supports numériques.
- Ensuite ce qui a accompagné l’informatique depuis ses débuts: barrettes-mémoire, disques durs, unités de stockage amovibles, imprimantes, scanners, photocopieurs … pour autant qu’ils ne seraient plus connectés … et qu’ils resteraient accessibles économiquement.
- Unités d’enregistrement photo, audio et vidéo
- courrier postal
- présentiel
La prévision de la métamorphose a cependant besoin de s’appuyer sur quelques hypothèses.
- La situation provoquerait une réflexion et un retour aux fondements réellement fonctionnels des pratiques (un naufragé recherche en tout premier lieu un abri et de quoi boire et manger).
- La transformation des pratiques ne s’opèrerait pas à partir des progrès technologiques des alternatives, mais à partir de leurs usages conventionnels. Les progrès technologiques viendraient “au secours du succès”.
- La rapidité des mutations entrainerait des demandes énormes et rapides. L’alternative retenue serait celle où il serait possible de répondre à ces demandes.
- Nombre de personnes, privées de smartphones, devraient se doter d’un poste informatique, d’où une demande forte pour des ordinateurs bon marché. À défaut, retour aux machines à écrire, à l’écriture manuscrite, aux rencontres physiques ou à des services divers… au moins temporairement. Pour certains… et peut-être pour beaucoup… le temporaire pourrait durer longtemps.
- Une permutation produit-service avec une floraison de services à chaque étape des processus de production: poste informatique mis à disposition, écrivain public ou équivalent, services d’impressions… et mise à disposition de services de connexion ultra-protégés payants, mais sans doute d’un maniement peu convivial.
- Dans le désordre ambiant, chaque grande puissance chercherait à conquérir des avantages géopolitiques. Les alternatives retenues devraient donc l’être à partir des ressources propres à chaque état, au moins dans un premier temps.
reformuler la mémorisation
En marge de la connexion, la fonction fondamentale de l’informatique c’est “la mémorisation”: mémoire de travail, archivage temporaire, compilations et accumulations. En découle la possibilité d’un retour sur un document même ancien et sa modification.
Cette facilité à être modifié peut s’envisager comme un avantage indéniable autant que comme un problème aigu de fiabilité. En ce sens le papier a gardé une dimension de “gravure dans le marbre” qui pourrait, plus que jamais, être perçue très positivement.
Le point faible du numérique concerne “l’archivage long” comme vu plus haut. Cependant ses concurrents (microfilm ou papier) souffrent d’un autre inconvénient: l’exigence d’un classement préalable selon un ordre prédéterminé. Dans un cas comme dans l’autre, le fonds créé est figé dans un classement susceptible, dans le temps, de devenir obsolète.
La reformulation fonctionnelle aurait sans doute à s’opérer selon un autre axe.
Aujourd’hui “tout” est mémorisé… “tout” et n’importe quoi… par les individus comme par les sociétés.”… tout spécialement des milliards d’images et de données personnelles (textes, dates, formulaires, selfies, SMS, “j’aime”… etc) redondantes pour l’essentiel. Il est permis de douter du retour sur investissement de cette gigantesque mise en mémoire. Le recueil massif de données personnelles s’effectue principalement par paresse: il dispense de toute analyse préalable. La mémorisation est omniprésente parce qu’elle est automatique et irréfléchie. Si elle devait devenir raisonnée, ou très coûteuse… ??
Dans ce nouveau contexte, on mémoriserait sans doute beaucoup, beaucoup moins.
La mémorisation concernerait surtout ce qui serait lié à une probabilité élevée de relecture. Or, dans le domaine de la lecture – surtout de la lecture “longue” – le papier n’a jamais perdu une forme d’hégémonie (livres, magazines …).
C’est ce cadre-là qui pourrait être celui du retour du papier, à l’instar d’autres pratiques anciennes revenues au goût du jour telles que le tramway, le vélo, la trottinette, la construction en bois, l’élevage des volailles en plein air…
Le retour du papier serait corrélé à celui du présentiel inévitable dans un contexte de déconnexion.
le papier
L’industrie papetière pose de graves problèmes environnementaux (consommation d’eau et d’énergie, pollution, déforestation…). Cependant:
- Ces mêmes problèmes environnementaux n’ont pas gêné l’essor du numérique
- Ces problèmes peuvent être relativisés pour le papier. Il existe beaucoup de façons d’en fabriquer à partir de nombreuses matières premières.
Portée par l’emballage, les livres et les produits d’hygiène, l’industrie papetière est restée très active. En termes de production, un retour au papier pourrait s’effectuer rapidement.
en guise de conclusion provisoire
(*) Goldman Sachs : «l’IA est surfaite, extrêmement coûteuse et peu fiable».
Le numérique en est arrivé à l’IA. Il n’offre “plus d’après”. Ce qui signifie que si l’IA déçoit, le… “plus d’après”… ce pourrait être… bientôt.
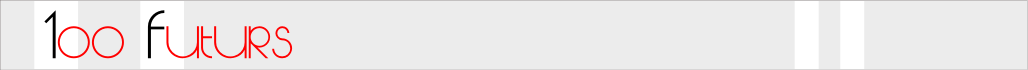

Laisser un commentaire