Pour aborder cette question, il va nous falloir distinguer deux types de paradoxes: les faux et les vrais. Seuls les seconds vont concerner l’approche du futur.
qu’est-ce qu’un paradoxe?
Cette notion se présente selon deux directions qui ont en commun de mettre en cause la démarche logique, mais selon des principes sensiblement différents (*)
PARADOXE de TYPE 1 ou “faux paradoxe”
(*) Affirmation surprenante en son fond et/ou en sa forme, qui contredit les idées reçues, l’opinion courante, les préjugés.
Selon cette première approche, le fondement du paradoxe est idéologique. Il y a paradoxe parce que nous “pensons mal”. Nous construisons une démarche logique sur la base de prémisses fausses. Ainsi en est-il lorsqu’on parle, par exemple, de “la victoire du plus faible”. S’il a gagné… c’est qu’il n’était pas le plus faible. C’est notre approche de la valeur qui était incorrecte.
Ce paradoxe-là n’en est pas vraiment un. Il signale seulement la nécessité d’un retour sur nos a priori.
Second exemple plus appliqué à notre propos:
(*) Selon l’Energy Institute, la transition énergétique mondiale montre un visage paradoxal sur l’année 2024 …/… elle accélère dans deux directions opposées.
Vues comme paradoxales les progressions conjointes des énergies renouvelables et des énergies fossiles fonctionnent sur la base d’un préjugé qui ne conçoit les énergies renouvelables que comme substitutions à l’utilisation des énergies fossiles – la présence du mot “transistion” dans le titre est à cet égard significative -. Or, il ne s’agit que d’une augmentation globale de la consommation qui laisse une place à toutes les sources d’énergie. Nous “pensons mal” une évolution par ailleurs assez transparente… et très peu paradoxale.
PARADOXE de TYPE 2 ou “vrai paradoxe”
(*) Antinomie, complexité contradictoire inhérente à la réalité de quelque chose
C’est ce paradoxe-là qu’il va falloir prendre en compte dans nos approches du futur. Il est lié à une relation de causalité. Il y a paradoxe lorsqu’un effet obtenu n’est pas seulement différent, mais surtout contraire à l’effet attendu.
Autour de ce paradoxe vont apparaitre notamment “l’effet rebond” – dit paradoxe de Jevons – et plus largement ce que l’on nomme les “rétroactions négatives”, lorsque celles-ci dépassent le stade de la simple atténuation du phénomène source. Nous allons en formuler quelques exemples ci-après.
PARADOXE de TYPE 3: les gadgets
Certains “gadgets paradoxaux” seront ignorés, car sans rôle tangible dans la problématique. Entreront dans cette catégorie les phrases autoréférentes comme le célèbre paradoxe du menteur, la phrase-icône de mai 68 «Il est interdit d’interdire», voire celle d’Albert Einstein «tout est relatif».
quelques exemples de “vrais paradoxes”
le paradoxe de Solow
L’avènement de l’informatique était supposé augmenter la productivité du travail. Le paradoxe de Solow affirme qu’il n’en a rien été.
Les rapports et documents devenant beaucoup plus faciles à produire et à modifier, les demandes de variantes et d’alternatives ont eu tendance à s’accumuler, appelant davantage de choix, des controverses plus nombreuses et plus complexes, des processus de validation plus longs, des responsabilités plus difficiles à assumer… d’où des concertations pour les diluer, des questions jamais vraiment closes avant certaines dates-butoirs. Les progrès de productivité dans les phases d’exécution ont permis de reculer les dates butoirs et d’augmenter ainsi la longueur des phases de décision. La révolution informatique a été un puissant moteur de la “réunionite” et par là de la stagnation – voire de l’affaiblissement – de la productivité.
Le paradoxe est dans ce cas lié à un effet – très à la mode aujourd’hui – l’effet rebond, effectif dans ce cas, alors qu’il est souvent utilisé à tort et à travers (voir “effet rebond: mécanique inéluctable, idéologie ou manipulation?”).
les rétroactions négatives de l’économique sur le climatique
(*) Dans une étude récente parue dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences, des chercheurs américains évaluent que les effets négatifs du réchauffement climatique sur l’économie ralentiraient les émissions de gaz à effet de serre.
Les chercheurs soulignent la difficulté d’évaluer le solde entre les rétroactions négatives et positives que l’évolution de l’économie pourrait présenter face au réchauffement. Ce qui nous amène aux deux exemples suivants.
les nuages peuvent aussi bien refroidir que réchauffer le climat
Cet exemple montre les paradoxes susceptibles de découler d’une réelle complexité. Il touche aux situations ou le bilan des rétroactions – positives et négatives – est extrêmement difficile à établir.
(*) Les nuages modulent le bilan radiatif de la Terre : les nuages bas possèdent un fort effet d’albédo et ils ont donc tendance à refroidir le climat, tandis que les nuages hauts augmentent l’effet de serre et réchauffent le climat.
Les rétroactions seraient négatives pour les nuages bas, mais positives pour les nuages hauts. Mais à partir de quand l’un devient-il l’autre? Question d’autant plus essentielle que le réchauffement augmente la quantité de nuages produits par l’océan.
Les plantes pourraient réchauffer le climat
(*) Les plantes, actrices clés de la régulation du climat, pourraient voir leur rôle bouleversé par le réchauffement. Une étude révèle que la hausse des températures les pousse à perdre plus d’eau, réduisant leur capacité à absorber le carbone …/… Cette fuite d’eau incontrôlable pourrait transformer les plantes en sources de carbone, aggravant le réchauffement climatique …/… Les chercheurs estiment qu’un point de bascule pourrait être atteint autour de 30 °C, où les plantes libéreraient plus de CO₂ qu’elles n’en absorbent.
Une rétroaction négative, supposée préserver l’équilibre du système, changerait de sens à partir d’un certain seuil… et deviendrait positive. Comment aborder ce seuil de température sachant qu’il va composer avec un grand nombre de variables: sans doute les espèces, mais aussi les heures de la journée, les saisons, le taux d’humidité de l’air et du sol – voire du sous-sol… ?
en guise de conclusion provisoire
Certains vrais paradoxes tels que ceux-ci sont restés longtemps invisibles et n’ont été révélés que récemment. Les tendances dans lesquels ils se sont avérés être inscrits – notamment pour ce qui concerne les végétaux – semblaient pourtant tout à fait stabilisées. Ce dernier exemple montre que des évolutions paradoxales pourraient se cacher partout.
Les rétroactions positives ne posent pas de problèmes conceptuels, elles amplifient le phénomène source. Les rétroactions négatives vont à contresens du phénomène source, sans pour autant en supprimer les effets. Elles s’évaluent sur la base d’un solde entre des forces opposées, c’est-à-dire sur une base “quantitative”… mais aléatoire. Peut-être faut-il voir derrière ce principe une expression “rationnelle” de l’imprévisible – alors que l’imprévisible est souvent invoqué par simple paresse -.
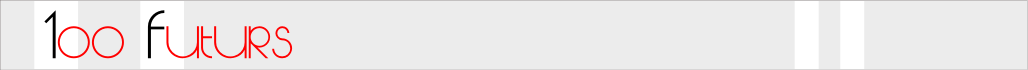
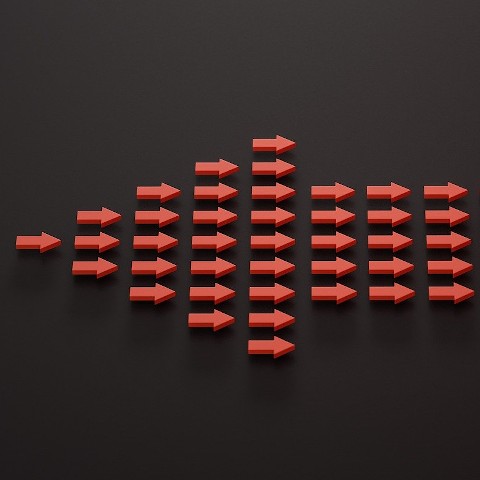
Laisser un commentaire